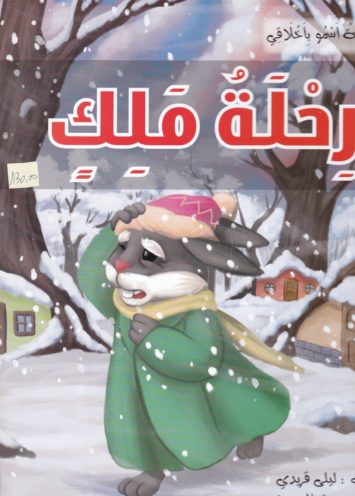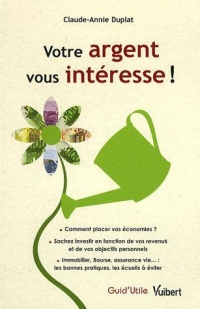Avis des consommateurs
Il n’y a pas encore d’avis.
Le Tiers Livre que Rabelais publie en 1546 est sans doute le premier ouvrage à traiter strictement de la notion de perplexité. Serai-je cocu ? Cette question cocasse fournit la matière de la première véritable mise en scène littéraire de la notion. Elle recueille les fruits d’un héritage savant, tant juridique que théologique. Pour les juristes, le terme de perplexitas désigne la situation particulièrement délicate où deux lois s’opposent l’une à l’autre, sans espoir de conciliation. Cette inacceptable antinomie réclame des méthodes de résolution originales (renvoi sine die, recours au hasard, mise en place d’une fictio legis, etc.) qui trouvent un écho direct chez des auteurs comme Rabelais et Montaigne. Pour les théologiens, le terme désigne prioritairement le conflit de la loi de l’Église et de la loi de la conscience. A priori impensable dans un monde où Dieu dit la même chose à son Église et à la conscience de chacun, la situation ne survient que par la faute du fidèle qui s’est mis lui-même dans la situation terrible d’inevitabilitas peccandi. Ce double éclairage permet de réévaluer l’histoire de Panurge. De la perplexité initiale du héros à sa résolution – problématique – dans le Cinquième Livre s’ébauche l’esquisse d’un cheminement « thélémique ». L’aventure de Panurge devient alors la métaphore de cet autre chemin retracé par différents textes contemporains, qui mène de la perplexité terrestre à la Jérusalem céleste, autre abbaye de Thélème.
Lire Plus
Il n’y a pas encore d’avis.